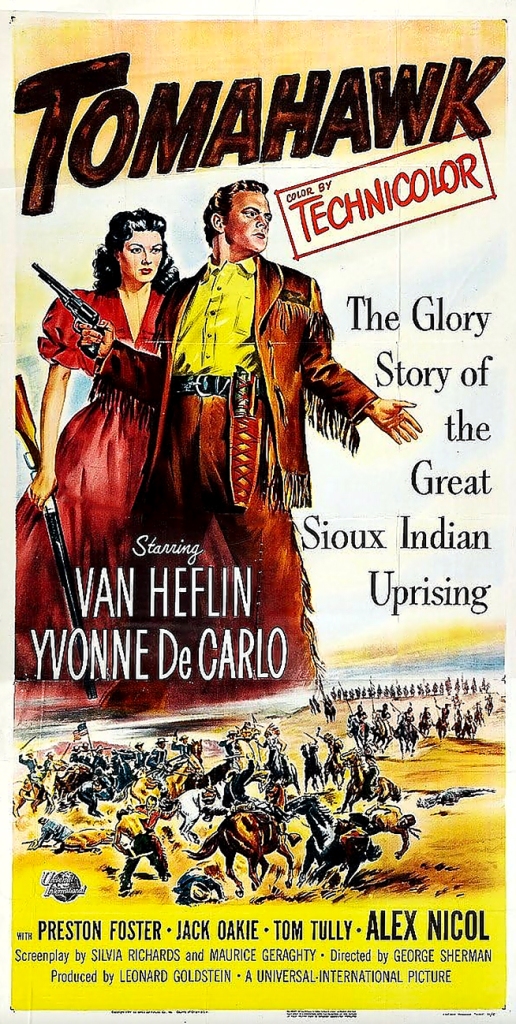« PASSEUR D’HOMMES » de J. Lee-Thompson fait partie de ses plus mauvais films (et on sait qu’il y a forte concurrence !), un des esthétiquement plus laids et des plus complaisants dans la violence.
Situé pendant la WW2 dans les Pyrénées, le scénario suit un vieux Basque (Anthony Quinn) chargé d’escorter jusqu’en Espagne, un chercheur (James Mason) et sa famille, pourchassés par un féroce nazi (Malcolm McDowell). Le scénario tient à peu près la distance, mais la réalisation de Thompson n’a jamais été aussi bâclée et démissionnaire et le montage est une catastrophe. Il est difficile pourtant de résister à une telle distribution et à ne pas prendre plaisir au numéro déjanté et over the top de McDowell en totale liberté, qui campe un sadique fou à lier : il faut l’avoir vu, déguisé en chef, hacher les doigts de Michel Lonsdale avec un couteau de cuisine, brûler vif le pauvre gitan Christopher Lee ou violer la pauvre Kay Lenz après lui avoir infligé la vision traumatisante de son slip kangourou à croix gammée. C’est du très grand n’importe quoi ! On l’entend même siffloter quelques notes de Beethoven, comme dans « ORANGE MÉCANIQUE ». Autour de lui, Quinn à 64 ans, n’a rien perdu de sa puissance physique en berger dur-à-cuire, Patricia Neal est émouvante en mère de famille qui se sacrifie pour sauver les siens, Marcel Bozzuffi apparaît brièvement en résistant héroïque. Mais malgré ces indéniables atouts, « PASSEUR D’HOMMES » est vraiment un ratage quasi complet, de la photo à la BO, culminant avec une des dernières séquences où McDowell, survivant à une avalanche, jaillit dans la cabane de Quinn, ensanglanté, Luger au point et menace tout le monde. On a envie de lui rappeler le vieil adage de Tuco : « Quand on doit tirer, on raconte pas sa vie ! ». À éviter soigneusement, tout ça…