
Inspiré d’un roman de Romain Gary, « CLAIR DE FEMME » est le 6ème et dernier film (si on compte le caméo de « SECTION SPÉCIALE ») que Costa-Gavras tourna avec Yves Montand. Il marque également les retrouvailles de celui-ci avec Romy Schneider, sa partenaire de « CÉSAR ET ROSALIE » sept ans plus tôt.
L’histoire est celle d’une nuit d’errance, celle d’un homme qui attend que sa femme, seule chez elle, se suicide pour abréger ses souffrances. Et sa rencontre avec Romy, qui a récemment perdu sa fille. Deux désespoirs qui s’accrochent l’un à l’autre, des rencontres pathétiques et sordides sur leur route. C’est extrêmement noir, le thème évoque parfois « LE DERNIER TANGO À PARIS ». Les deux vedettes, un peu vieillies, n’ont rien perdu de leur talent. Hélas, le dialogue est terriblement littéraire, tuant trop souvent la possibilité d’une émotion sincère. Montand est excellent, surtout dans ses moments de sombre dérision, elle comme toujours, est à fleur de peau. Mais quelque chose ne passe pas : ils parlent trop, s’analysent trop. Il y des séquences longues et pénibles (le music-hall avec le numéro de chiens, à se flinguer), d’autres sont riches et teintées de folie (la soirée russe), mais le film ne convainc qu’à 50%. Heureusement, Gavras a choisi de grandes pointures dans de petits rôles : Lila Kedrova en belle-mère fantasque, François Perrot extraordinaire, Romolo Valli et Heinz Bennent dans une courte séquence au téléphone. On reconnaît des débutants comme Jean Reno en képi et Roberto Begnini en barman volubile. « CLAIR DE FEMME » aurait probablement pu être un beau film, s’il s’était un peu plus éloigné de sa source romanesque, pour traduire en images la noirceur lyrique du texte. C’est dommage, mais il mérite d’être vu pour sa distribution.

















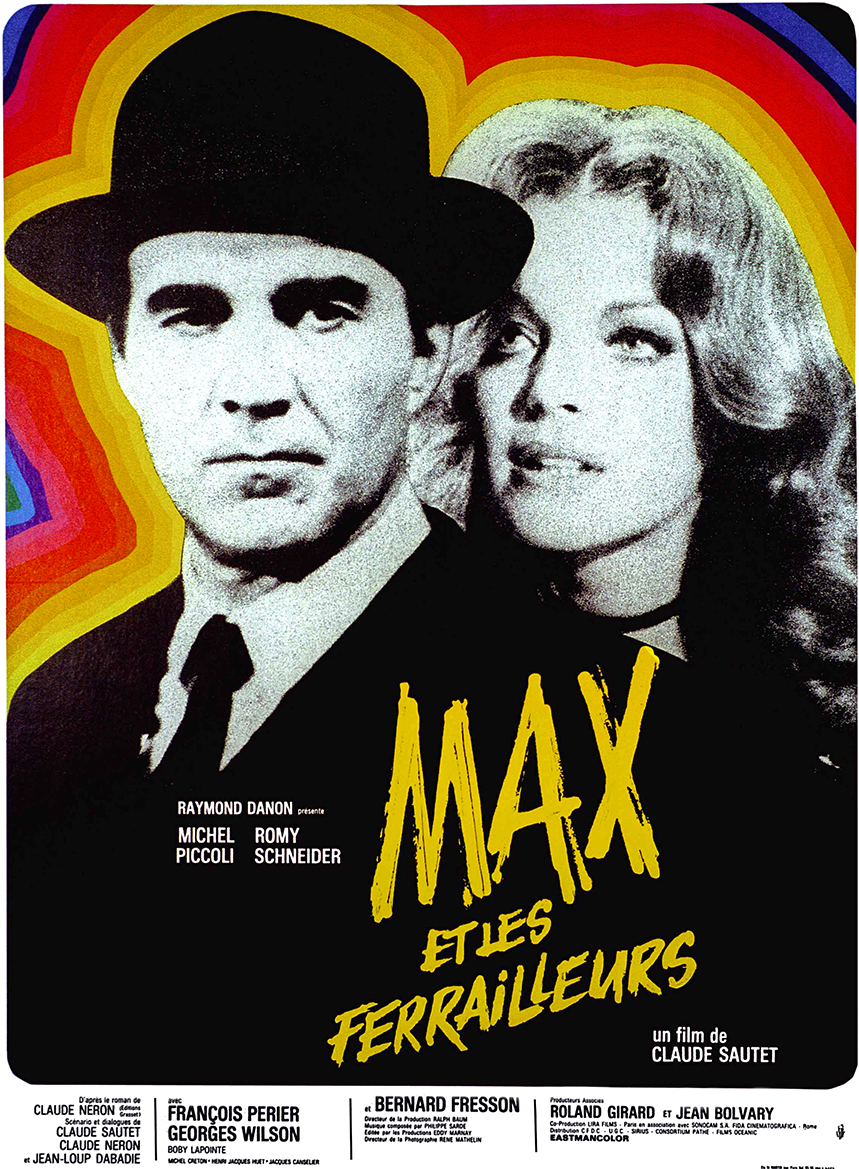


 Il n’est pas toujours évident de définir ce qui rend un film « parfait », indémodable et incritiquable, d’autant plus qu’on ne tombe pas dessus aussi fréquemment qu’on le souhaiterait. L’alchimie se produit parfois de façon inattendue. Ainsi, « LE VIEUX FUSIL », aujourd’hui considéré de façon unanime comme un indiscutable classique du cinéma français, aurait pu n’être qu’un film de guerre mâtiné de « vigilante movie » et ne pas perdurer.
Il n’est pas toujours évident de définir ce qui rend un film « parfait », indémodable et incritiquable, d’autant plus qu’on ne tombe pas dessus aussi fréquemment qu’on le souhaiterait. L’alchimie se produit parfois de façon inattendue. Ainsi, « LE VIEUX FUSIL », aujourd’hui considéré de façon unanime comme un indiscutable classique du cinéma français, aurait pu n’être qu’un film de guerre mâtiné de « vigilante movie » et ne pas perdurer.