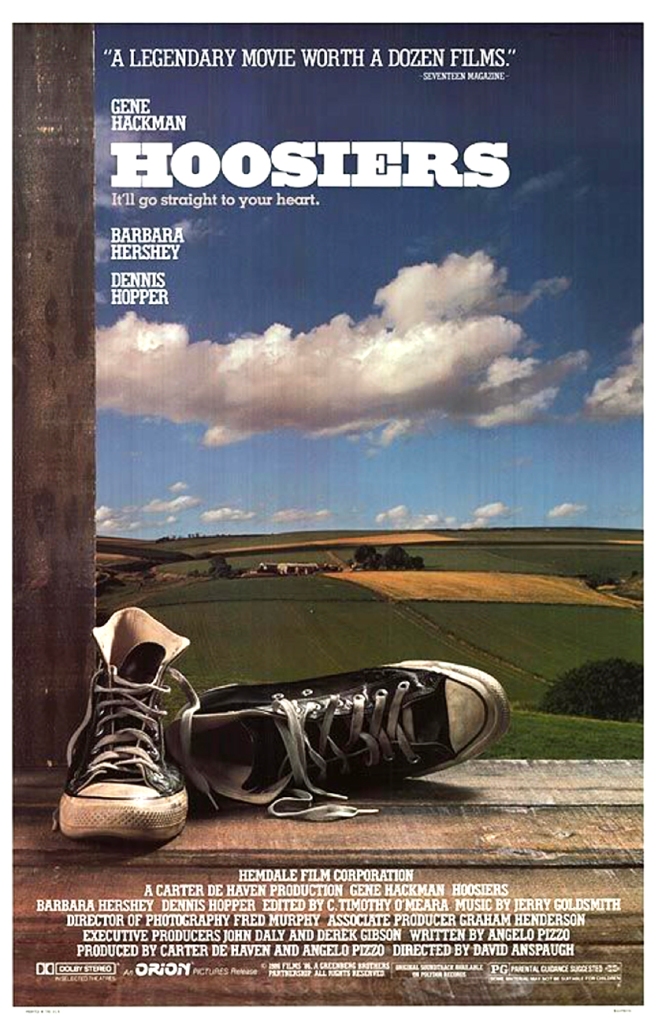« CARNAGE » de Michael Ritchie démarre sur les images d’un abattoir où un homme est (littéralement) haché menu puis transformé en chapelet de saucisses. La suite garde ce côté choquant et écœurant, qui devient la marque de fabrique du film et sa spécificité.
Pour clore son tryptique hard boiled entamé avec « À BOUT PORTANT » et « LE POINT DE NON-RETOUR », Lee Marvin incarne un hitman de Chicago chargé d’abattre un éleveur de Kansas City (Gene Hackman) qui fait du trafic de mineures qu’il vend comme du bétail. Un point de départ radical qui tourne court assez vite par la faute d’un scénario mal construit, sans enjeu véritable, qui se traîne pendant une bonne demi-heure avant de se réveiller vers la fin pour un showdown bien sanglant et truffé d’images-choc (la poursuite avec la moissonneuse, la fusillade dans le champ de tournesols). Tourné juste après « FRENCH CONNECTION » qui n’était pas encore sorti, le film offre un rôle épisodique à Hackman de grosse brute taurine, amateur de tripes frites baignant dans la graisse. Le face à face avec Marvin est donc frustrant et n’a rien du duel de géants promis par l’affiche. Le grand Lee traverse le film dans son beau costume, avec un calme olympien. C’est toujours un plaisir de le voir manier les armes lourdes et arborer son demi-sourire narquois. Il forme un couple étrange mais intéressant avec Sissy Spacek jouant une orpheline qu’il sauve du marché aux esclaves. Les seconds rôles n’ont rien d’exceptionnel mais remplissent bien leur office. À noter la présence au début du film, dans un rôle de gangster, d’Eddie Egan, l’ex-flic dont Hackman venait de tenir le rôle dans « FRENCH CONNECTION » ! « CARNAGE » avait tout pour plaire, mais Ritchie manque de punch, de sens du cadre et d’humour noir pour en faire un classique de la série B seventies. Cela reste plaisant grâce à Marvin, encore dans sa grande période, qui vaut à lui seul le déplacement.
À noter : la longue séquence de poursuite dans les champs annonce très nettement celle du film d’Yves Boisset : « CANICULE », où Marvin revivait la même situation.