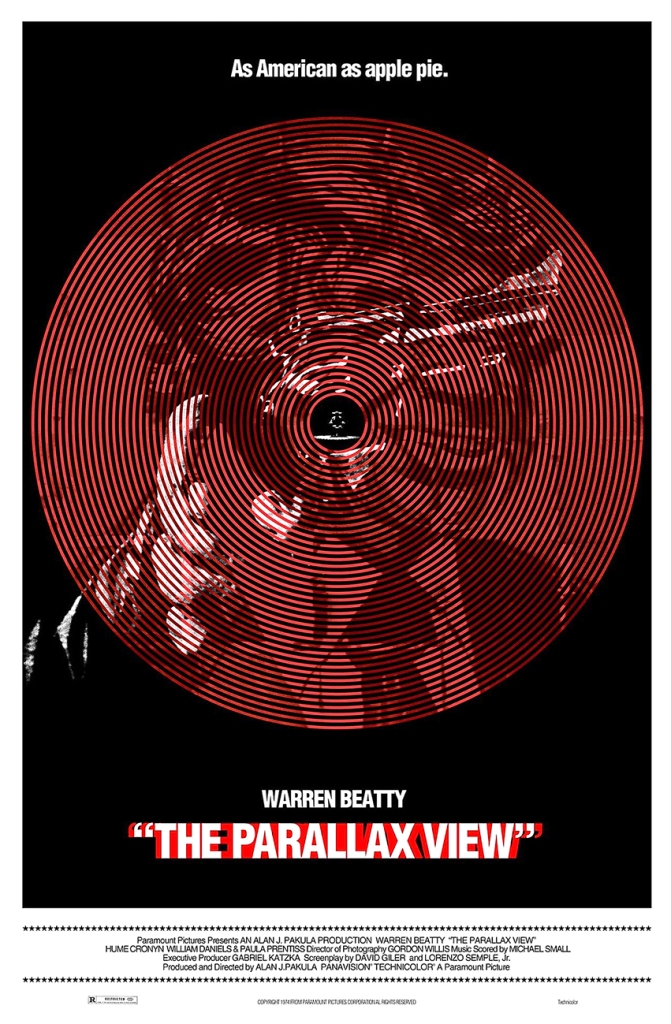Adapté d’une Série Noire de Francis Ryck, « LE SECRET » de Robert Enrico est un thriller paranoïaque typique des années 70, qui confronte trois personnages à la machine d’État prête à éradiquer le moindre obstacle – ou potentiel obstacle – sur sa route.
Évadé d’un HP spécialisé dans la torture mentale et physique, Jean-Louis Trintignant se réfugie à la campagne, dans la maison délabrée d’un soixante-huitard rangé des voitures (Philippe Noiret) qui y vit avec sa femme (Marlène Jobert). C’est principalement un film d’acteurs centré sur le trio de vedettes, les seconds rôles ne sont que des silhouettes à peine filmées. C’est un festival Trintignant qui se délecte visiblement d’un rôle écrit sur-mesure de fugitif pathétique et dangereux, tout en ambiguïté et en contradictions. Il excelle dans cet emploi, surtout dans les moments où il dérape dans la mythomanie et le délire de persécution. On pense à la scène où il abat un forestier innocent, par exemple, à faire froid dans le dos. Face à lui, Noiret se repose beaucoup sur ses tics de jeu dans un rôle parfois illogique et irritant de vieil ours naïf et crédule. Jobert se débat courageusement avec un personnage pénible et sans relief. On aperçoit au début du film l’inquiétant Antoine St. John (« IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION ») en infirmier. « LE SECRET » n’est pas un grand film, les rebondissements sont trop téléphonés, le côté kafkaïen est trop ou pas assez développé et le dénouement, sur une plage des Landes, laisse curieusement insatisfait. Mais on se console avec une jolie BO d’Ennio Morricone (qui remplace François de Roubaix, le film étant une copro italienne) et le plaisir, malgré tout, de revoir ces beaux acteurs dans la force de l’âge, dans quelques séquences fortes et intenses.